Tome 5 : A comme Amérindiens. Le retour des Amérindiens
(Extrait de mon Bloc-notes 2009. Tony Hillerman, Jim Harrison, Peter Matthiessen et autres écrivains défenseurs des Indiens d'Amérique)
Je veux parler de l’étrange retour des Amérindiens, les « native Americans » comme ils les appellent là-bas, dans la littérature nord-américaine contemporaine. Il y a quelques années nous étions partis à Carnac pour une semaine nous remettre d’un hiver interminable avec thalasso, régime diététique aux fruits de mer, et jouir de l’air vivifiant de l’Océan et de cette luminosité toute particulière que l’on trouve en Bretagne quand il fait beau et que le vent a nettoyé le ciel. Et lire un peu. J’avais emmené, entre autres, deux livres de ma bibliothèque sur deux auteurs américains que j’aime bien : Tony Hillerman, le créateur du roman policier Navajo, et Jim Harrison, l’auteur de ces chefs d’œuvre que sont Légendes d’automne et Dalva.
Tony Hillerman
Mais chez Tony Hillerman il y a autre chose. Si ses policiers Joe Leaphorn et Jim Chee sont tous les deux des Indiens Navajos et si toutes ses histoires se passent en terrain Navajo, on sent aussi que l’auteur est au moins autant intéressé à nous apprendre quelque chose sur cette population qu’à nous faire participer à une intrigue policière. Je me suis donc demandé d’où venait cette passion de Hillerman pour les Navajos et quels étaient exactement les liens qu’il avait avec eux. Le Tony Hillerman Companion m’a apporté les réponses à ces questions. Jon L. Breen qui est un critique littéraire spécialisé dans le roman policier lui pose carrément la question quand il interviewe Hillerman au téléphone en mars 1993 : « Beaucoup de vos lecteurs croient que vous êtes un Navajo vous-même. Comment se fait-il que vous ayez une connaissance aussi extensive de la culture de ce peuple ? » « Je suis né dans un petit village de l’Oklahoma où mon père possédait une ferme et un petit magasin au croisement des routes », lui répond Hillerman. « Au départ c’était une vieille mission créée par les Bénédictins qui y avait créé une école indienne. J’étais élève de cette école pendant huit ans et mes condisciples étaient des Indiens Potawatomis et Séminoles. J’ai donc appris dès mon enfance que les Indiens n’étaient pas essentiellement différents par rapport à moi. Apprendre cela quand on est enfant est facile. L’apprendre plus tard est quelquefois impossible… ». Quand il revient de la guerre (grand blessé, il avait même pendant un moment perdu la vue), il travaille comme chauffeur, amenant du matériel pétrolier sur le territoire de la réserve Navajo et assiste à une cérémonie sacrée, appelée Enemy Way, organisée pour des marins Navajos revenus de la guerre du Pacifique. Il est très impressionné et puis, quand il travaille plus tard comme journaliste (il fera encore une maîtrise en journalisme et l’enseignera à l’Université d’Albuquerque au Nouveau Mexique) il a de nouveau l’occasion d’observer les Navajos dans leur réserve, de discuter avec eux, d’en faire ses amis et de parfaire sa connaissance de leur culture par les livres. Et finalement de les intégrer dans ses romans. Ce que j’apprécie tout particulièrement dans la culture Navajo, dit-il, c’est que l’idéal auquel on aspire c’est d’être en harmonie avec son environnement, avec les vicissitudes de la vie. Ils appellent ce principe le « hozho ». Quand on ne peut pas changer quelque chose on se met en harmonie avec. Et puis dans leur échelle de valeurs ils placent la famille tout en haut et les possessions matérielles au plus bas. Bien sûr il y a aussi des aspects négatifs, dit-il encore, la crainte, l’idée de la sorcellerie.
Il faut dire que les Navajos sont une peuplade bien attachante. Le Tony Hillerman Companion comprend une courte notice qui parle d’eux, de leur histoire et de leur terre. C’est la plus grande des réserves indiennes des Etats-Unis. Le territoire se trouve dans le coin Nord-Est de l’Etat d’Arizona et s’étend jusqu’au Nouveau Mexique et en Utah. Vastes plateaux, vallées d’un vert pâle, absence d’arbres, impression d’espace sans limites, à l’horizon des dunes, des canyons de couleur orange, de hautes montagnes bleues (c’est chez eux qu’est située la fameuse Monument Valley). De terribles orages. Des pluies soudaines et torrentielles. Les Navajos sont arrivés sur cette terre il y a 600 ans. Ils ont appris l’élevage des moutons et des chevaux des Espagnols, peut-être aussi le travail de l’argent, et l’agriculture et le tissage de leurs voisins, les Hopis et d’autres tribus de la culture Pueblo. Au cours des deux derniers siècles ils ont eu une histoire mouvementée. A la fin du XVIIIème siècle les Espagnols ont fait de nombreux raids dans leur territoire, prenant des esclaves, détruisant leurs troupeaux et leurs récoltes, leur enlevant des terres. Et en 1821, lors d’une conférence soi-disant de paix, ils ont traîtreusement assassiné 24 envoyés Navajos pendant qu’ils étaient en train de fumer le calumet. Les Américains sont arrivés en 1840, mais ont vite déçu les espoirs que les Navajos avaient placés en eux. Non seulement ils facilitent la traite des Espagnols, mais envahissent la terre des Navajos, détruisent les récoltes eux aussi et, en 1849, assassinent leur plus grand chef, un homme déjà âgé, connu sous le nom de Narbona. Un poste militaire est créé en 1851, de nombreux traités sont signés, aucun n’est tenu, et, en 1862, le général James H. Carleton les oblige à quitter leur terre : 8000 Navajos doivent parcourir 500 km à pied pour aller se fixer dans un no man’s land plat et désert, appelé Bosque Redondo, du côté de Santa Fe (c’est La Longue Marche). Les autres, il faut les soumettre complètement ou les exterminer, dit-il. C’est le Colonel Christopher Kit Carson, connu par les épopées de la Frontier, qui va s’en charger, les pourchassant et les exterminant. Quatre ans plus tard, le quart des Navajos parqués à Bosque Redondo étaient morts de faim ou de maladie, leurs récoltes desséchées par manque d’eau. Il n’y avait pas de bois pour faire du feu et l’eau impropre à la consommation. Finalement, en 1868, l’un de leurs chefs arrive à fléchir Washington, les Navajos acceptent de vivre dans une réserve à condition que ce soit sur leurs terres ancestrales et un nouveau traité est signé le 1er juin 1868 qui va être plus ou moins respecté. Il faudra qu’un jour j’en parle, dans mon Voyage, de cet incroyable génocide que les Européens ont perpétré dans les deux Amériques. Si je crois ce qu’en dit David Stannard, professeur à l’Université de Hawaï, la population indigène totale des deux Amériques se situait, avant l’arrivée de Colomb, entre 75 et 100 Millions dont 8 à 12 Millions vivaient au nord du Mexique et le taux d’extermination par tueries et maladies a été de l’ordre de 90% (voir David E. Stannard : American Holocaust, the Conquest of the New World, édit. Oxford University Press, Londres/New-York, 1992). La mère de tous les génocides ! On comprend que certains écrivains américains ressentent un sacré sentiment de culpabilité !
Hillerman reconnaît la dette qu’il a envers Arthur Upfield. Il avait lu quelques unes de ses histoires à l’âge de 10-11 ans déjà et avait gardé en mémoire ses descriptions du bush australien et de ses étranges habitants, les Aborigènes. Ses meilleurs romans, dit-il, sont ceux où le rôle joué par les mœurs des Aborigènes, leurs coutumes, leurs pratiques magiques, est plus important que l’intrigue. Il en cite 3 dans son interview : The bone is pointed, The will of the tribe, Death of the Lake. J’ai trouvé les deux premiers en traduction française dans la bibliothèque de vieux romans policiers de ma fille (collection 10/18, série Jean-Claude Zylberstein). Et quand le malheur nous a soudain frappés, que Annie se trouvait à l’hôpital, paralysée des jambes à cause d’une tumeur cancéreuse qui lui avait écrasé la moelle épinière, en pleine déprime, et que je stressais à mort, incapable de trouver le sommeil tout seul dans mon lit, je les ai tous lus les Upfield de la bibliothèque de ma fille (il y en avait une bonne quinzaine) et ils m’ont fait beaucoup de bien car, toutes les nuits, je me suis endormi dans le bush australien ! Mais Hillerman trouve que le policier Napoléon Bonaparte, à moitié Aborigène, est trop stéréotypé et un peu « superman ». Il cite aussi le nom du roman qu’il trouve le plus mauvais, Royal Abduction. Or c’est justement celui-là qu’il préface lors de sa réédition américaine en 1984 ! Arthur Upfield était anglais, avait été expédié par son père en Australie à l’âge de 19 ans, roule sa bosse dans le bush, part à la guerre, puis revient parcourir le pays pendant 10 ans en faisant tous les métiers et finit par faire la connaissance d’un véritable policier métis, du nom de Tracker Leon, qui lui raconte sa vie, ses aventures, ses souvenirs aborigènes (sa mère l’était), et, avant de disparaître, échange des bouquins avec Upfield parmi lesquels un livre sur Napoléon Bonaparte… Et voilà, Upfield a trouvé sa voie, son héros et son nom.
J’ai 3 romans de Tony Hillerman dans ma bibliothèque, Dance Hall of the Dead (édit. The Armchair Detective Library, New-York, exemplaire signé par l’auteur), Talking God et Coyote waits (édit. Harper & Row Publishers, New-York). C’est le premier des trois, publié pour la première fois en 1973, qui est le meilleur à mon goût. Peut-être parce qu’il met en scène une autre tribu indienne, les Zunis, et que cela permet à Hillerman de montrer que chaque peuple indien est différent et a d’autres croyances (au moment d’écrire ce roman sa fille s’était fiancée avec un Indien Zuni, raconte-t-il dans la préface de mon édition). Les Zunis vivent cernés par trois réserves de Navajos et ne sont guère leurs amis. Mais quand leur jeune dieu du feu est assassiné c’est bien un policier Navajo qui va mener l’enquête. C’est cette confrontation qui est intéressante. Ce roman a été traduit en français sous le titre de Là où dansent les morts et publié par l’éditeur Rivages, Paris en 1986 (encore un que j’ai trouvé dans la bibliothèque de ma fille).
Tony Hillerman est mort en août 2008, à l’âge de 83 ans. D’autres auteurs de romans policiers ont suivi son exemple : Jean Hager met en scène des Cherokees (la série des Molly Bearpaw, avec Ravenmocker, et celle des Mitch Bushyhead, avec The Fire Carrier) et Jake Page des Zapatos et d’autres tribus (Shoot the Moon, édit. Bobbs-Merrill, 1979, traduction française : La case de l’oncle Tomahawk, édit. Gallimard-Série Noire, 1980) et, avec son épouse Suzanne, les Hopis (Suzanne and Jack Page : Hopi, édit. Abrams, 1982). Il y a même un éminent scientifique, spécialiste de la supraconductivité, et qui vit au Nouveau Mexique, qui a créé des policiers Ute et des intrigues en pays indien entre Los Alamos et Taos (voir James D. Doss : The Shaman laughs, 1995, traduction française : Le canyon des ombres, édit. 10/18, 2000).
Jim Harrison La fuite des Cheyennes en 1878
D’ailleurs son premier grand personnage féminin, son alter ego de l’autre sexe, Dalva, a du sang sioux et un amant sioux. Et l’arrière-grand-père de Harrison, John Wesley Northridge, botaniste et missionnaire auprès des Sioux Oglalas, d’abord très naïf, puis devenant de plus en plus furieux devant les traités bafoués par les Blancs, les déportations, les massacres même (il assiste à l’horrible massacre de Wounded Knee de 1890, presque la fin du XIXème siècle – Ford commence déjà à travailler à sa voiture, dit Harrison quelque part), perd la foi en sa religion et en son gouvernement. Il passe du côté des Indiens. Il cache les chefs sioux. Et je ne me souviens plus si c’est dans Dalva ou dans sa suite, La Route du Retour, que l’on trouve les ossements d’officiers de l’armée américaine que le vieux Northridge avait tués pour sauver ses amis sioux (la fiction et la réalité se mélangent...).
On comprendra alors toute l’importance que les peuples indiens, leur culture, leur histoire, ont pour Jim Harrison. « Il ne manque pas une occasion de soutenir la cause indienne », dit Mattieussent, « de promouvoir les livres des écrivains indiens ou de défendre les actions des militants indiens dans tous les Etats de l’Union, et en particulier dans le Michigan ». Il est d’ailleurs un grand ami de l’écrivain indien James Welch, car il faut savoir qu’il y a toute une génération d’écrivains qui ont du sang indien et qui font revivre la mémoire d’une culture disparue. J’ai eu la chance de trouver un libraire-antiquaire spécialisé dans ce domaine qui habite la Nouvelle Angleterre (Ken Lopez, à Hadley, dans le Massasuchets) et qui m’a procuré plusieurs de ces livres et en particulier celui-ci de Welch : James Welch : Fools Crow, édit. Viking Penguin, New-York, 1986. C’est un livre très poignant qui décrit la tragique destinée (mais aussi la façon de vivre depuis les temps anciens, sa culture, ses croyances) d’un petit groupe de Blackfeet (les ancêtres de Welch) habitant le Nord-Ouest du Montana, pressé par les Blancs, se demandant s’ils doivent se battre ou capituler ou combiner les deux attitudes, forcé par la Cavalerie de migrer vers le Nord et finalement succomber.
Cela me rappelle que près d’un demi-siècle plus tôt un autre écrivain, qui n’avait pas de sang indien dans les veines, mais un grand sens de l’injustice, Howard Fast, auteur de Spartacus et condamné à la prison et au chômage par McCarthy pour appartenance au Parti communiste américain, avait décrit dans un livre magistral, plein de compassion et d’indignation, probablement son meilleur, la longue marche de 300 Cheyennes de l’Oklahoma où ils étaient parqués et mouraient de faim jusqu’au Montana, alors qu’ils étaient poursuivis et harcelés par près de 10000 soldats, sous l’ordre du général Crook, voir Howard Fast : The last Frontier, édit. Duell, Sloan & Pearce, New-York, 1941.
Peter Matthiessen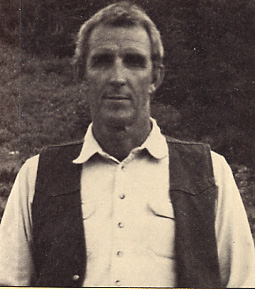
Il y a encore d’autres écrivains américains – et c’est tout à leur honneur – qui parlent du drame des Amérindiens. Ainsi cet écrivain que j’aime énormément, John Savage, surtout à cause de ce chef d’œuvre qu’est The Power of the Dog (édit. Van Vactor & Goodheart, Cambridge, Mass., 1967), et qui, dans Rue du Pacifique (édit. Belfond, Paris, 2006 – le titre original est The Corner of Rice and Pacific), évoque le sort des Shoshones : A Grayling, dans le Montana, deux familles s’affrontent, le fermier John Metlen et le maire qui est aussi banquier Martin Connor. La famille Metlen a pour ami le chef des Shoshones, une tribu inoffensive qui vit dans la région, et son fils est l’ami de leur fils. Et puis un jour on apprend que les Shoshones vont être chassés de leurs terres pour être envoyés dans une réserve au Kansas. L’épouse du fermier fait tout pour l’empêcher mais elle se heurte à la volonté et le pouvoir du banquier. Et d’ailleurs le Président des Etats-Unis a déjà signé l’ordre… « Les Indiens de ce pays avaient été condamnés dès que les premiers pèlerins avaient posé le pied sur le rocher de Plymouth. Les Blancs voulaient les biens des Indiens ; et, par le fusil et la tricherie ils les obtinrent. A présent il n’y avait plus de place dans la société américaine pour les Indiens, sauf en tant que phénomènes à exhiber dans des cirques ou autres spectacles itinérants… »
Les grands écrivains américains de l’intérieur (c. à d. ceux qui ne sont pas de Manhattan ou du Bronx) ne peuvent être classés suivant des critères gauche/droite classiques, à l’européenne. Le socialisme est mort en Amérique après l’échec des grandes luttes sociales du début du XXème siècle et a reçu son coup de grâce avec la guerre froide et l’amalgame socialisme/communisme. Et puis tous ces écrivains sont malgré tout tous marqués par l’histoire de la Frontier, attachés à la liberté, font passer l’individualisme avant la solidarité, sont tous un peu anarchistes, et détestent tout ce qui est fédéral et les politiciens de Washington. Ce qui n’empêche qu’ils ont gardé le sens de l’injustice des anciens, de Jack London, de John Steinbeck et d’Upton Sinclair, et qu’ils sont encore capables de faire une critique féroce de l’American way of life et du nouveau capitalisme financier, comme le fait magistralement John Frantzen dans The Corrections (édit. Farrar, Straus and Giroux, New-York, 2001). Et beaucoup d’entre eux rappellent aux Américains le grand tort fait aux premiers habitants de ce pays. Et c’est bien ainsi parce que le grand public l’ignore ou s’en fout. « Après avoir tourné la dernière page d’Indian Country », écrit le critique du Washington Post, « j’étais tellement en colère que j’avais envie de monter sur les toits et de crier : réveille-toi, Amérique, avant que, Bon Dieu, il ne soit définitivement trop tard ! ».
(2009/2015)